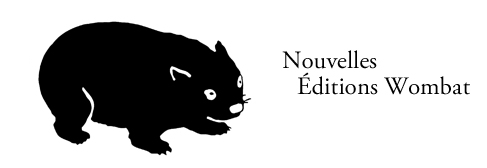
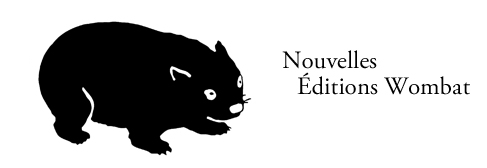

Un des témoignages les plus drôles jamais écrits sur la Seconde Guerre mondiale !
« À la gare de Victoria, l’officier chargé des transports me remit un laissez-passer, une plume blanche et un portrait d’Hitler sur lequel on pouvait lire “Voici votre ennemi”. Je fouillai dans tous les compartiments, mais il n’était pas dans le train… »
En septembre 1939, Spike Milligan, jeune Londonien de vingt et un ans, reçoit du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté un carton l’invitant à participer à la guerre. Cramponné à son doudou, il est arraché à la douceur d’un foyer des plus loufoques et envoyé comme opérateur radio sur la côte sud de l’Angleterre ; il s’y illustre d’emblée en tentant d’abattre un avion nazi à l’aide d’une simple brique… Mais, très vite, l’artilleur Milligan préfère se prélasser sur son lit de camp, jouer de la trompette et se laisser aller aux plaisanteries et aux farces de caserne, avant d’être envoyé manu militari sur le front d’Afrique du Nord…
Avec un humour irrésistible, Spike nous décrit les personnalités, les chefs, les petites et les grandes manœuvres de son unité indisciplinée et goguenarde, transformant le « comique troupier » en grand art.

Né en Inde, irlandais d’origine, Spike Milligan (1918-2002) est considéré comme le plus grand auteur comique anglais de la seconde moitié du XXe siècle, aussi populaire en Grande-Bretagne qu’un Coluche ou un Desproges en France.
Jeune soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, puis musicien dans un orchestre de jazz, il devient dans les années 1950 le scénariste et l’une des vedettes, avec Peter Sellers et Harry Secombe, du « Goon Show », émission radio déjantée de la BBC, admirée aussi bien par Marcel Gotlib que par les Monty Python (« Spike Milligan est notre Dieu à tous », dixit John Cleese).
Comédien et écrivain prolifique, auteur de nombreux pastiches (de la Bible à Robin des Bois) et de plusieurs romans (dont Le Règne hystérique de Siffoney Ier, roi d’Irlande, Wombat, 2015), il inaugurait avec Mon rôle dans la chute d’Adolf Hitler ses « Mémoires de guerre », son œuvre la plus lue outre-Manche.
Marqué à jamais par la guerre, Spike Milligan souffrira toute sa vie de dépression, laissant à sa disparition en 2002 cette fameuse épitaphe : « Je vous avais bien dit que j’étais malade ! »
Gotlib : Quels sont vos « maîtres » en humour ?
Terry Jones : Puisqu’on est en France, je dirais Jacques Tati. Et un comique anglais, Spike Milligan.
Gotlib : Je l’ai rencontré une fois, on a dîné ensemble.
Terry Jones : Le « Goon Show » a été immensément important pour nous.
Gotlib : Il y a cinq ans, quand on a commencé Fluide glacial, je voulais adapter les sketchs du « Goon Show » en bande dessinée. J’ai eu un rendez-vous avec Spike Milligan à Londres, il était d’accord. Mais quand je m’y suis mis, je me suis rendu compte que je n’y arriverais pas. C’était trop difficile, trop anglais.
Eric Idle : Les gags qu’ils avaient sur le « Goon Show », c’était le plus souvent des gags « à combustion lente ». Il ne se passait rien. Je n’ai pas souvenir d’avoir ri aussi fort devant une autre émission. Je les trouvais hystériques. Surtout, ils allaient loin. Cette idée de prendre des risques avec les gags, c’était quelque chose qu’on admirait tous.
© Propos recueillis par Jacques Diament. (Source : Schnock nº12)
« Tous les faits importants relatés ici sont véridiques ; j’en ai enjolivé certains à ma manière, mais, je le répète, sur le fond tout est vrai. J’ai utilisé l’idiome tout simple de la caserne et le contingent réglementaire de gros mots. Certaines de mes révélations sont extrêmement grossières, mais je rapporte les choses exactement telles que je les ai vues se dérouler. Ce n’était pas toujours drôle, mais, comme vous allez le voir, ça l’était quand même souvent. L’expérience de la vie militaire a transformé mon existence entière ; jamais je n’aurais cru qu’une organisation telle que la nôtre pouvait se permettre d’entrer en guerre, sans parler d’en sortir victorieuse. Ce fut, comme disait Yeats en parlant du soulèvement de Pâques en Irlande, “d’une beauté terrible”. J’ai vu mourir certains de mes amis, donc, en dépit de tout l’humour que j’ai voulu mettre dans ce texte, cette réalité subsistera toujours dans un petit coin de mon esprit ; mais s’ils étaient encore parmi nous aujourd’hui, ils auraient été les premiers à rire aux éclats – et ce rire a été, j’en suis sûr, la clef de notre victoire. »
Un jour, une enveloppe émanant du gouvernement de Sa Majesté vint échouer sur notre paillasson. « L’heure de mon appendicite a sonné », me dis-je.
– Pour l’amour de Dieu, ne l’ouvre pas ! s’écria mon oncle en la tapotant du bout de sa canne. La dernière fois que j’en ai ouvert une, je me suis retrouvé en Mésopotamie, pourchassé par des Turcs qui agitaient des pots de vaseline en criant « Lawrence, on t’aime ! » en ottoman.
Papa regarda sa montre.
– C’est l’heure d’une nouvelle avancée, annonça-t-il, et il fit un pas en avant.
Des semaines s’écoulèrent, ponctuées par plusieurs autres lettres émanant du gouvernement de Sa Majesté, lesquelles finirent par arriver à raison de deux par jour, portant toutes l’indication « URGENT ».
– Le roi doit avoir une très haute opinion de toi, fiston, pour t’écrire aussi souvent, fit remarquer ma mère en descendant péniblement des sacs de charbon à la cave.
Un dimanche, alors que Maman était occupée à rejointoyer les murs de la maison, Papa s’offrit le luxe d’ouvrir une de ces enveloppes. Il trouva dedans une invitation – rédigée avec beaucoup de roublardise – à prendre part à la Seconde Guerre mondiale, avec, pour commencer, une solde de sept shillings et six pence la semaine, tout compris.
– Tu te rends compte, dit Maman en emportant Papa au premier étage pour lui faire prendre son bain, parmi tous les habitants de l’Angleterre, c’est toi qu’on a choisi ; c’est un grand honneur, fiston.
Le rire aux lèvres, je l’envoyai au tapis d’un crochet du droit.
Je parvins à retarder le jour fatal. […] Cela faisait à présent trois mois que j’avais reçu mon ordre de mobilisation. Pour fêter l’événement, je me cachai sous mon lit, déguisé en Florence Nightingale. Le lendemain matin, je reçus un carton me priant d’assister à une visite médicale à la caserne du régiment des Yorkshire Creys à Eltham.
– Fiston, me dit mon père, je crois qu’il vaut mieux y aller, on commence à être à court de déguisements ; de toute façon, quand ils te verront, ils vont sûrement te renvoyer ici vite fait.
Le carton stipulait que je devais me présenter à « 9 h 30 précises ». J’arrivai donc à 9 h 30 précises et je fus reçu précisément à 12 h 15. Nous fûmes tous priés de nous déloquer, ce qui dévoila une multitude de jeunes gens pâlichons aux jambes maigres, blanches et poilues. Le sergent recruteur arrêta de justesse un photographe de presse.
– Nom d’un chien ! ne les prenez pas en photo ! Si la population voit ce ramassis de conscrits, elle va immédiatement réclamer un armistice.
Je finis par arriver en présence d’un médecin chauve et blême.
– Comment vous sentez-vous ? me demanda-t-il.
– Pas mal, dis-je.
– Vous avez l’impression d’être en forme ?
– Non, je suis venu à pied.
Avec un sourire méchant il inscrivit sur ma carte « Catégorie 1 » à l’encre rouge.
– Vous ne mettez pas votre toque noire pour prononcer ma condamnation à mort ? demandai-je.
– Elle est au lavage, répondit-il.
Le sort en était jeté. Jour de gloire pour les Milligan que celui où l’on me fit quitter le toit paternel.
– Je suis trop jeune pour partir ! hurlai-je, tandis que des hommes de la police militaire m’arrachaient de ma poussette, cramponné à mon doudou.
À la gare de Victoria, l’officier chargé des transports me remit un permis de voyager, une plume blanche et un portrait d’Hitler sur lequel on avait écrit : « Voici votre ennemi. » Je fouillai tous les compartiments, mais il n’était pas dans le train. À 4 h 30, le 2 juin 1940, par une belle journée de ciel bleu et de cirrus en forme de queues de chat, nous arrivâmes à Bexhill-on-Sea, où je quittai le train. Ce ne fut pas facile. Il ne s’arrêtait pas à la gare de Bexhill.
