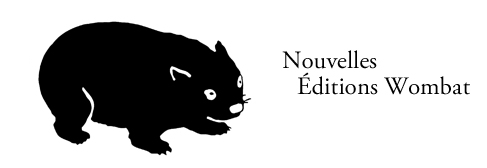
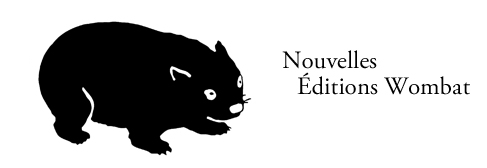

« Il n’y avait pas deux mecs assez fous pour mener cette bande de sauvages ! Il n’y avait que Choron, encore plus sauvage que les autres, qui pouvait mener une bande de dingues pareils ! » (Georges Bernier)
D’une authenticité sans fard, les mémoires tragicomiques de Georges Bernier, alias le Professeur Choron, livrent une hallucinante et réelle contre-histoire de la France des années 1930 aux années 1990. Va-nu-pieds issu d’une famille modeste, ouvrier itinérant puis voyou, arnaqueur, proxénète ou gigolo, Bernier raconte sa jeunesse misérable et la sale guerre d’Indochine, où il s’engage de 1949 à 1952. Réformé de l’armée pour tuberculose, il croise sur le pavé de Paris la route de François Cavanna avec qui il créera Hara-Kiri (1960-1985) puis Charlie hebdo (1970-1982).
De Cavanna à Reiser et Wolinski, de son pote Coluche à sa fille Michèle Bernier, de l’Olympia à Canal +, ce Diogène moderne, d’une totale intransigeance, qui révolutionna la presse et l’humour français, retrace dans cette virulente et hilarante autobiographie, qui se dévore comme un roman, un destin d’homme, d’éditeur, d’artiste et de libre penseur exceptionnel.

Né dans un petit village de Champagne-Ardenne, Georget (dit Georges) Bernier (1929-2005) s’engage dans l’armée en 1948 et traverse les horreurs de la guerre d’Indochine. De retour à Paris, ce meneur d’hommes exceptionnel rencontre François Cavanna, avec qui il fonde la désormais légendaire revue Hara-Kiri (1960-1985) puis le groupe des éditions du Square, qui verra naître Charlie hebdo en 1970, ainsi que La Gueule ouverte (première grande revue écolo) et les revues de BD Charlie mensuel, Surprise, BD…
En 1962, il invente pour un roman photo le Professeur Choron, personnage inclassable, bricoleur pince-sans-rire au comique noir absurde, qui scandalise les spectateurs de l’émission de Jean-Christophe Averty « Les Raisins verts » (sur l’ORTF) en les incitant à briser leur télé ou à passer des bébés à la moulinette. Créateur des Jeux de con et des inénarrables Fiches bricolage, qu’il réalisera plus tard en sketches pour Canal +, cet excellent chansonnier se produisit à l’Olympia en 1981.
Épaulé par toute la bande d’Hara-Kiri, le Professeur Choron, prince des provocateurs, anar et dionysiaque, incarna quarante ans durant l’esprit « bête et méchant » qui révolutionna l’humour français, de Coluche à Groland.
Sur la guerre d’Indochine (1952)
« Et un jour, fatalement, en 1952… Ça faisait plus de deux ans et demi que j’étais là. Arrive un télégramme de l’état-major de Hanoi avec mon nom dessus. Fallait rapatrier. Le séjour était de vingt-sept ou vingt-huit mois. Le plus difficile, c’est d’annoncer la nouvelle à ma petite N’Guyen-Ty. On était quand même tombés amoureux l’un de l’autre. On a vécu plus de deux ans ensemble. Pour la calmer, je lui dis : “Tu sais pas, je t’emmènerai avec moi jusqu’à Haiphong et puis on essaiera de se payer un grand hôtel. Et on ira au théâtre et chez le coiffeur.” C’était une vraie paysanne. Elle avait jamais vu la ville. Rien que la promesse de l’emmener à Haiphong, ça l’a un peu calmée. Un jour, est arrivé un camion. Il a fallu faire les adieux au village de Luc Nam. On avait picolé avec les copains. Les copains, tu les laisses. Je laisse le copain Bardot. Je laisse le sergent-chef Dolcy. On se bourre la gueule. Et puis tu t’en vas, mais à contrecœur. Dans le fond tu sais bien que tu les laisses dans la merde, que les Viets sont de plus en plus nombreux et pas loin. Tu pars un peu comme un salaud. Tu n’es pas heureux de partir, mais le GMC est là. J’ai fait grimper ma nénette dedans, j’ai mis mon sac marin, j’ai dit salut aux copains, on a traversé le village. Tous les habitants me faisaient au revoir. J’avais quand même été deux ans avec eux, les voyant tous les jours. Boire une bière dans une cagna, boire du choum-choum dans l’autre. Ils chantaient : “Ce n’est qu’un au revoir.” C’est peut-être nous qui leur avions appris, quand les copains nous quittaient et qu’on était bourrés. J’étais sacrément ému.
On arrive, tartinés de poussière comme d’habitude, à Haiphong. Je devais embarquer trois, quatre jours après. Je me dis, j’ai un peu de pognon sur moi, je vais pas me faire chier à aller dans le camp de toile. En plus j’ai ma femme. Il y avait un hôtel, le Grand Hôtel Luc Haï Tiong. J’allais payer ça à N’Guyen-Ty. Je me suis renseigné, quel jour part le bateau, à quelle heure, de quel endroit. Y a plus qu’à attendre ce moment-là. On a passé cinq jours dans Haiphong, à traîner les théâtres vietnamiens, à aller dans les restaurants. Je l’avais envoyée chez le coiffeur. Elle s’était fait friser et maquiller. Elle était belle comme tout. Je lui avais payé une espèce de chasuble en satin, ou en soie, fendue des deux côtés. Elle arrêtait pas de se regarder dans la glace. Elle était magnifique.
On était dans la chambre du Grand Hôtel, face à la baie d’Along. Je lui dis : “Je dois m’en aller, chérie. Il faut se quitter.” Embrassade. La chemise cramponnée par ses petites mains. J’arrive à me dégager. J’empoigne mon sac et je me dirige vers l’endroit du port où on devait embarquer. Et j’entends derrière moi des claquettes en bois qui cavalent, qui font du bruit. Le soir tombait, il faisait presque nuit. Je me sens agrippé à la chemise. N’Guyen-Ty qui revenait à la charge. J’avais beau lui promettre que j’allais revenir, que j’allais faire un deuxième séjour, elle revenait pour que je l’emmène. Dans sa tête, elle croyait que je pouvais l’emmener en France, mais c’était pas possible. C’était interdit. Sinon, je l’aurais embarquée avec moi, je l’aurais fourrée dans mon sac. J’étais déjà à la bourre, j’allais rater le bateau. Je me suis retourné et je lui ai foutu un coup de poing à assommer un buffle. La pauvre N’Guyen-Ty s’est écroulée par terre. Ses claquettes sont parties de tous les côtés. Et j’ai commencé à presser le pas jusqu’au LCT qui devait nous faire traverser la baie et nous emmener au bateau. C’est comme ça que j’ai quitté N’Guyen-Ty et le Viêt-nam. Je me suis retrouvé sur le Pasteur. La baie d’Along était pleine de jonques, avec des voiles comme des ailes de chauve-souris. La nuit commençait à tomber. Le soleil était très bas. J’ai quitté le Viêt-nam comme ça, au début de la nuit. Ma petite femme, que j’avais assommée, se traînait sur le pavé. »
Sur Hara-Kiri (1966)
« 1966. Des millions d’enfants pleurent Walt Disney, mort à Burbank, en Californie. Heureusement, il leur reste Hara-Kiri. 240 000 de tirage. Mais pas pour longtemps ! Un matin, re-Journal officiel. Hara-Kiri se retrouve encore une fois interdit à l’affichage pour les mêmes raisons. Pornographie ! Sous prétexte, toujours, de protéger les chères petites têtes blondes. Alors qu’on faisait un journal pour les adultes ! À la première interdiction [en 1961], on ne savait pas ce que c’était. On croyait que ça pouvait se lever du jour au lendemain. Tandis que là, tout le monde savait. Y avait plus à raconter de salades. Choron pouvait pas monter sur la table en disant : “Les gars, je vais vous arranger le coup, dans un mois on reparaît.” Tous les mecs ont pris conscience que Hara-Kiri était fini. Ils ont décidé carrément de foutre le camp ! Ils en avaient marre de Choron. (…)
Cavanna n’avait pas fait partie de la bande. Il était trop proche de moi pour que les mecs lui fassent confiance. Mais je me disais : “Dans le fond, ils ont peut-être raison.” Je n’avais encore jamais démarché de gros éditeurs. J’en parle avec Cavanna. “J’aimerais bien que tu sois avec moi.” Le premier rendez-vous qu’on a pris, c’était avec Max Corre, le patron de Paris-Presse l’Intransigeant. C’était une espèce de gros ponte à France-Soir, qui faisait la pluie et le beau temps. Il nous a reçus. “En effet, c’est un beau journal, Hara-Kiri. Oui, très bien, je prends note, on vous écrira.” On est allés voir Pauwels, qui avait à cette époque-là des revues qui marchaient, comme Planète. Planète, je crois que ça vendait autour de deux cent mille exemplaires. Ils avaient du pognon. Pauwels nous a fait le même coup que Corre : “Il est très bien, votre journal. Dommage que vous soyez interdit. Je vais en parler à Bergier.” Finalement, jamais de nouvelles. Après, on a une autre idée : Goscinny, un copain, venait bouffer deux ou trois fois par mois rue Choron. Il vend un million d’Astérix. On a déjeuné avec lui dans un restaurant rue Montmartre. Et Goscinny, pareil : “Ah, quel malheur. C’est une loi de merde, une loi pourrie.” On lui explique qu’on est prêts à travailler avec d’autres personnes qui nous apporteront des appuis. J’ai senti que c’était foutu quand il a dit : “Je vais en parler à Dargaud.” Georges Dargaud, que j’ai connu par la suite, avait quand même le Petit Jésus pendu par une chaîne autour du cou. Qu’est-ce qui restait ? On n’allait pas aller voir Pauvert, il était encore plus pauvre que nous. Ni Régine Deforges, ni Éric Losfeld. On n’intéressait personne. On n’intéressait pas les groupes. Et pourquoi on n’intéressait pas ces groupes-là ? Un journal, c’est un moyen d’acheter de la publicité, de faire rentrer des recettes publicitaires. Et, dans Hara-Kiri, c’était net, on n’aurait jamais de pub. Les gros groupes, ça ne les intéressait pas du tout de nous faire plaisir, de traîner un journal comme Hara-Kiri.
Je voyais Hara-Kiri mal parti avec cette nouvelle interdiction. Énorme merde financière ! Beaucoup plus grosse qu’à la première interdiction. On tirait davantage, puisqu’on tirait à deux cent quarante mille ! Donc plus grosse dette d’imprimerie, plus grosse dette de papier. Entre-temps la Sécu m’était tombée dessus, pour que les gars soient salariés, et tout le merdier. Grosse dette de Sécurité sociale. Et grosse dette de loyer. On payait un loyer assez cher. On avait des locaux assez grands. C’était intenable. Les huissiers défilaient toute la journée ! D’ailleurs, on les laissait faire, on les laissait rentrer avec leur papier bleu. Ils saisissaient tous les mêmes choses. Un jour, je lis les feuilles bleues, et je vois écrit : “Un nègre en bois.” Je me dis, merde, où c’est qu’il a pu trouver un nègre en bois ? Après réflexion, j’ai pensé à Melvin Van Peebles, qui a fait son chemin depuis, aux États-Unis, avec plusieurs films. Il venait bouffer tous les midis. Il baisait même la bonne espagnole, dans le cagibi d’en bas. Après qu’il avait bouffé, il allait dans la salle de rédaction et il dormait. Et pendant qu’il dormait, il y a un huissier qui est rentré. Étant donné que la salle de rédaction, c’était quand même une caverne d’Ali Baba, avec le grand lustre 1900 pendu au plafond, les queues de billard, des tableaux, le gars a carrément marqué : “Un nègre en bois.” C’était Melvin ! »
Choron chanteur (début années 1980)
« On a fait la chose impossible, c’est-à-dire qu’on a tourné un clip dans un abattoir. Il est absolument interdit d’y aller sans une autorisation spéciale. Comment trouver un abattoir ? On avait un copain qui habitait à côté de Blois, Daniel Fuchs, le frère de Jean. Il connaissait un vétérinaire, le véritable patron de l’abattoir. Il faisait ce qu’il voulait. Il était alcoolo cent pour cent. On a eu l’autorisation du vétérinaire à coups de whisky ! On est arrivés la veille. Il fallait être présents le lendemain matin de bonne heure. C’est comme lorsqu’on guillotine les mecs, toujours au petit matin. Il fallait être en forme, quand même. Et c’était mon premier play-back. J’en avais jamais fait de ma putain de vie. Il faut vraiment se coucher de bonne heure ! Et comme d’habitude, la veille, on se réunit, on boit un coup. Le lendemain, rendez-vous à l’abattoir à 4 h 30 du matin. Il y avait un grand couloir où on tuait les bœufs. Ailleurs les moutons attendaient. Et il y avait l’endroit où on passait les cochons. J’ai eu la trouille parce que je connais les cochons, je suis un plouc. Les cochons, ça mord. Je me disais : ils doivent sentir qu’ils vont crever, les animaux. Je suis rentré au milieu des cochons, sans bottes, avec mes petites godasses, mes pantalons, mon pardessus, pour chanter Mamamoudia ! J’avais ces putains de cochons qui me bouffaient le bas des pantalons et, au milieu de tout ça, la sono se met à faire badaboum, badaboum, badaboum, et moi qui commence à chanter ! Pendant ce temps, les mecs, avec leur prise électrique, clac, hop, ils enserraient la tête des cochons, les cochons gigotaient un peu, pan ils tombaient ! Après, le gars les saigne au-dessus d’un caniveau. Le sang coulait dans le caniveau. On fait les premières prises. Après, on rentre davantage dans l’abattoir. Là, ça découpe à la scie les cochons pas encore tout à fait morts ! La viande coule de partout. On fait ça, évidemment, pas à jeun. Tu fais pas ça à jeun. On avait dégotté, dans le coin, de l’alcool de poire du pays. Je grimpais sur les carcasses de cochons en chantant. C’était la première fois que je faisais un play-back complètement réussi. Il faut le voir pour le croire ! Dans une ambiance comme ça, démente, on a tourné Mamamoudia, un chef-d’œuvre. Nous, on avait vraiment trouvé le climat de violence ! Où on tue les cochons ! Où on égorge les moutons !
Il y avait des cultivateurs qui amenaient des moutons dans leurs bras. Les moutons balançaient de petits coups de langue sur leurs joues mal rasées. Ils les posaient. Il y avait le couloir de la mort avec les bœufs. Les bœufs avaient pissé partout de trouille. Dans ce couloir un grand bœuf dépassait tous les autres. Il me regardait chanter ! Les autres s’en foutaient mais lui il avait la tête tournée vers moi, avec des cornes extraordinaires. J’en ai rêvé, de ce bœuf, pendant des semaines et des semaines ! La nuit, je me réveillais avec ce bœuf qui me regardait. Il est mort. Il a eu de la chance : il a vu Choron chanter ! Il a été content. Les autres se rendaient pas compte, ils étaient trop bêtes. »
© Nouvelles Éditions Wombat 2018.
« On aurait pu s’attendre à un ouvrage bâclé, perdu dans les effluves de Ricard. C’est tout le contraire. Ce livre de souvenirs du professeur Choron, cocréateur d’Hara-Kiri, est construit, surprenant, parfois même profond. (…) On mesure aussi combien l’alcool bu en quantités astronomiques a pu attiser la créativité verbale du professeur, tout en faisant de sa vie un chaos permanent. Ces Mémoires ne sont pas écrits en argot, mais en Choron, une langue à part, parfaitement restituée par son coauteur et confesseur, Jean-Marie Gourio, qui dit dans sa préface : “Choron était un monstre de vie.” On ne saurait mieux dire. À noter qu’une bibliographie très complète de la bande d’Hara-Kiri achève de faire de cet ouvrage un objet hautement recommandable. » (Jérôme Dupuis, L’Express)
« Si vous allez ce week-end faire un tour chez votre libraire, une suggestion : glissez dans votre cabas la réédition des Mémoires du Professeur Choron. (…) Écrit avec la verve bien connue du personnage (épaulé en l’occurrence par Jean-Marie Gourio, qui lui a tenu le micro et un peu la plume, tout en lui interdisant de boire), ce livre décapant est un témoignage à la fois drôle et instructif, un vrai document sur la vie dans la France pauvre des années 1930 et 1940, sur la guerre d’Indochine que Georges Bernier a faite à 20 ans, et sur l’aventure Hara-Kiri depuis le premier numéro, vendu par colportage à l’automne 1960. Si l’histoire de la presse vous intéresse, c’est une mine d’or, truffée d’anecdotes impayables et d’épisodes rocambolesques… » (Bernard Quiriny, Le Point)
« Georges Bernier, fils de cheminot et de garde-barrière, a grandi misérablement à la campagne. Puis ce fut la guerre. Puis il a fait l’Indochine. Puis il a fait Hara-Kiri et tout ce qui en découla et est devenu ainsi le Professeur Choron. Son autobiographie est formidable. Narré avec la verve du prof, rédigé à l’aide de l’excellente plume de Gourio, le livre se déguste comme un Bukowski ou un Fante à la française. Les anecdotes fourmillent, les moments historiques sont là, l’absence de pudeur expose aussi bien les côtés sympathiques du personnage que ceux plus crus et moins respectables. Son esprit d’improvisation, son goût pour la liberté et son sens de la démerde lui permirent de mener à bien pas mal de carrières sans jamais les avoir vraiment anticipées. Absolument indispensable, drôle et passionnant. » (Jean-François Caritte, Psikopat)